Publié le 14 janvier 2025. Par Cloé Lachaux.
Vers plus de démocratie participative : le référendum
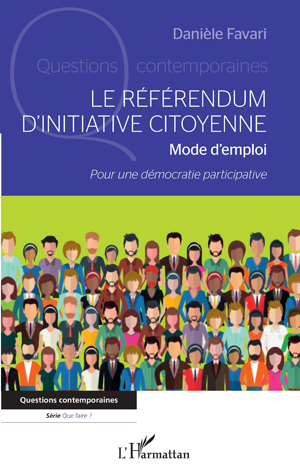 Danièle Favari, Le Référendum d’Initiative Citoyenne mode d’emploi, pour une démocratie participative, L’Harmattan, 2022.
Danièle Favari, Le Référendum d’Initiative Citoyenne mode d’emploi, pour une démocratie participative, L’Harmattan, 2022.
Danièle Favari est juriste, autrice et conférencière, spécialiste des questions du libre-échange. Elle est notamment connue pour ses engagements pour la défense de l’environnement et contre la surexploitation des hydrocarbures. Elle défend ici le Référendum d’Initiative Citoyenne, moyen, selon elle, de redonner la parole aux citoyens.
Considérant qu’il est indispensable de remettre les citoyens au cœur des décisions démocratiques, Danièle Favari propose quelques pistes pour un Référendum d’Initiative Citoyenne en France.
Après avoir fait un état des lieux de la situation française, elle définit des modalités d’amélioration, en se basant sur la thèse de Condorcet, le père fondateur du RIC, et sur l’article 28 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui stipule “qu’un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la Constitution”.
Le cas français
À ce jour, le pouvoir d’influence de la population vis-à-vis de leurs institutions est quasi nul : elle dispose uniquement de la Question Prioritaire de Constitutionnalité. Parmi les quatre types de référendum qui existent en France (le législatif, le constituant, le local et le Référendum d’Initiative Partagée), aucun ne peut être initié par les citoyens.
En pratique, l’objet des référendums est limité aux services publics et aux politiques économiques, sociales et environnementales.
Mais, plus grave pour l’autrice, les gouvernements successifs changent la Constitution sans référendum en utilisant une procédure, l’article 89, pensée pour n’être utilisée que rarement.
Les modalités du RIC en France
Pour pallier la déresponsabilisation des citoyens dans la vie démocratique, Danièle Favari pense que nous devrions importer le système de RIC en France, mais y ajoute ses propres modalités.
Le cadre juridique
Dans un premier temps, la mise en place du RIC impliquerait nécessairement de modifier et compléter certains articles de la Constitution, en y intégrant la souveraineté nationale et la responsabilité politique des citoyens.
Une fois ce socle consolidé, la proposition de loi serait initiée par un électorat de nationalité française qui formerait un comité citoyen. Ce comité élaborerait la base juridique de la proposition qu’il transmettrait à une chambre référendaire chargée de sa rédaction définitive. Les membres de cette chambre seraient tirés au sort et bénéficieraient du même statut que les parlementaires actuels, et de l’aide de spécialistes (avocats, juristes, etc.).
Pour être valable juridiquement, la conformité de cette proposition (libellé, bien fondé, etc.) devrait être vérifiée par le Conseil constitutionnel. Dans le cas où elle ne serait pas jugée conforme, elle serait renvoyée à la chambre référendaire, qui disposerait d’un délai d’un mois pour la modifier.
Les différents types de RIC
Pour Danièle Favari, le RIC ne devrait pas traiter des droits fondamentaux, ni d’acquis sociaux, mais il pourrait :
- traiter de textes législatifs ou constitutionnels (révision totale ou partielle). Ce serait la seule exception pour laquelle le Parlement pourrait être à l’initiative d’une proposition ;
- traiter de l’abrogation d’une loi en vigueur, à l’exclusion des lois votées lors de précédents RIC ;
- être révocatoire (le peuple pourrait révoquer des élus dès la moitié de leur mandat) ;
- être une question de principe ;
- être un projet concret, mais pas trop spécifique.
Les modalités pratiques du RIC
Pour être valable, une proposition de loi nécessiterait un minimum de 700.000 signatures collectées sur un site dédié et dans des points d’accès, avant de pouvoir être soumise à un vote national. Un délai de plusieurs mois après l’obtention de ces signatures permettrait d’amender, de discuter et de compléter la proposition.
Une fois le référendum voté, via une question unique, claire et binaire (en cas de vote obligatoire comme non obligatoire), la proposition serait adoptée à la majorité simple ou relative (soit plus de 50% des inscrits). Si la proposition n’est pas adoptée, alors toute proposition similaire durant les deux années consécutives à ce vote seraient caduques. Si, à l’inverse, elle est adoptée, elle peut toujours faire l’objet d’un veto initié par une majorité d’électeurs.
Ce qui se fait ailleurs dans le monde
Très peu connue du grand public, l’Initiative Citoyenne Européenne permet de soumettre une proposition de changement législatif à la Commission Européenne. Elle nécessite un soutien d’au moins un million de signataires de sept états-membres différents.
Le RIC est déjà monnaie courante dans de nombreux pays, tels que l’Allemagne, l’Uruguay ou la Californie, mais la Suisse reste la référence. Le RIC y est prévu par la Constitution depuis 1848, selon le postulat que les citoyens sont tout aussi compétents que les élus pour décider. D’ailleurs, la Constitution ne peut être modifiée que par cette procédure référendaire.
*
A travers le RIC, Danièle Favari fait valoir la nécessité de replacer les citoyens au cœur du processus démocratique. Elle souligne le travail des associations engagées dans la défense de cette thèse et rappelle que la mise en place du RIC ne peut se faire que grâce à l’initiative d’un gouvernement conscient de la détermination du peuple français à être l’acteur principal de la vie politique.



