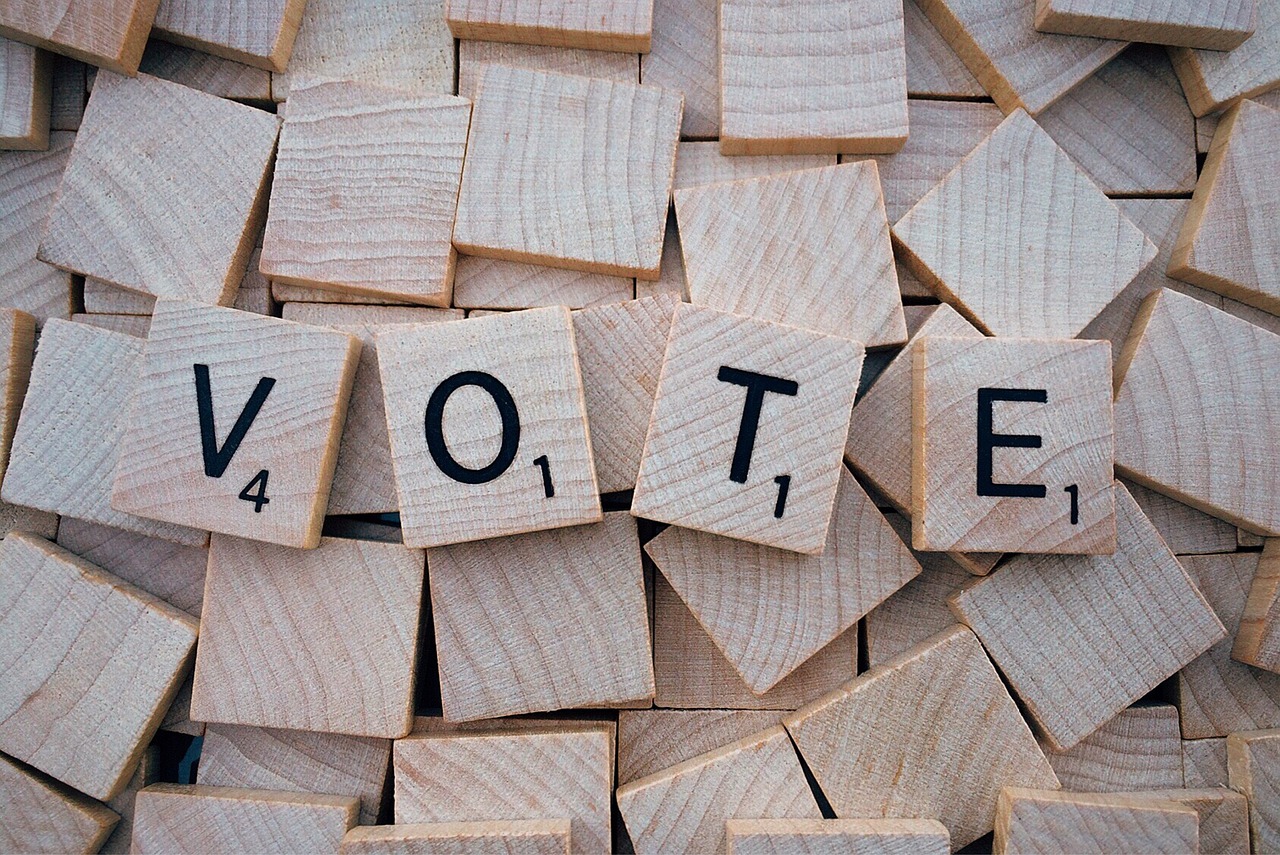Publié le 22 janvier 2025. Par Cloé Lachaux.
« Ben alors, pourquoi tu votes pas ? »
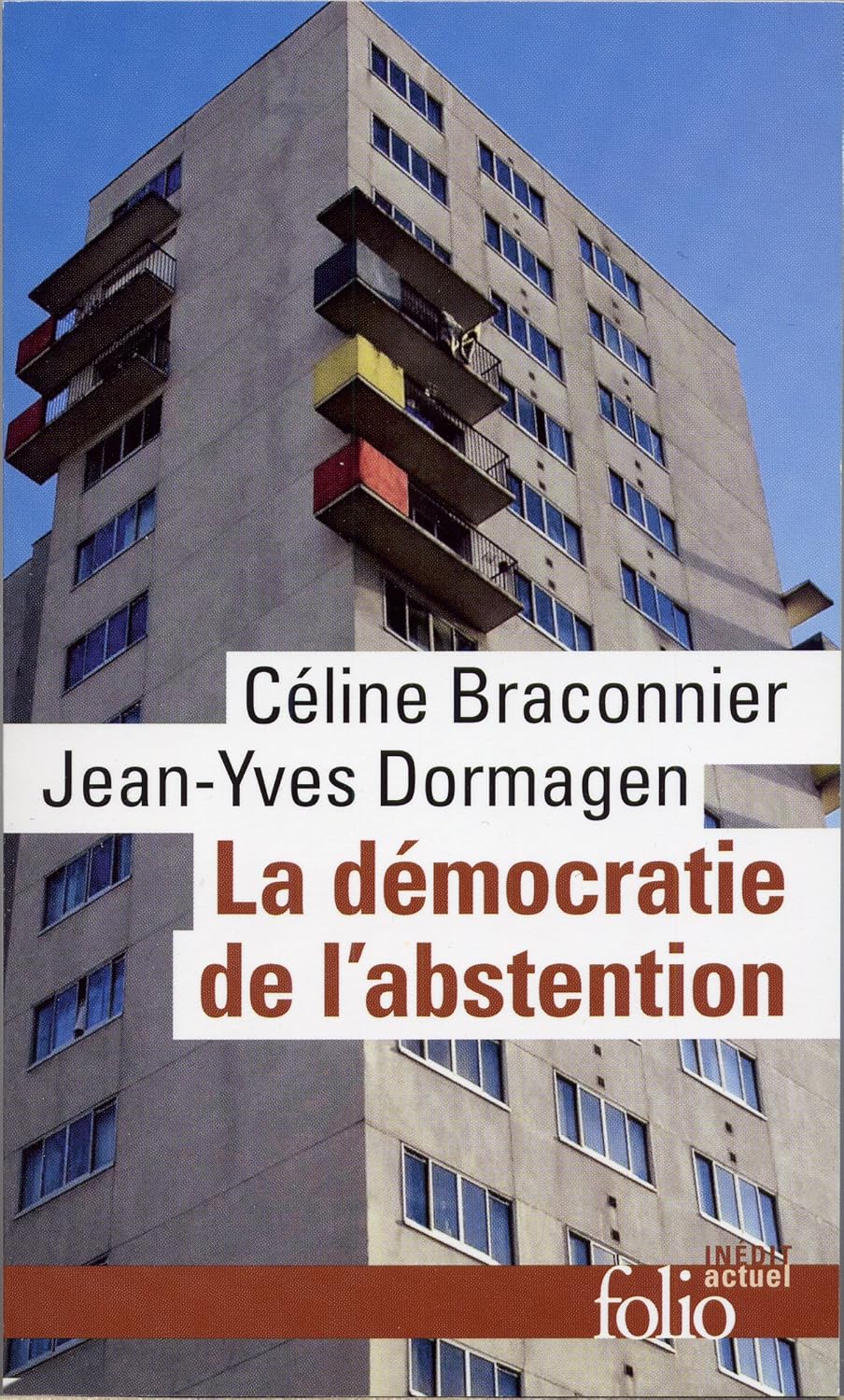 Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagen, La démocratie de l’abstention, Folio, 2007
Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagen, La démocratie de l’abstention, Folio, 2007
Jean-Yves Dormagen est un écrivain, professeur de sciences politique à l’université de Montpellier. Il s’associe avec Céline Braconnier, écrivaine régulière de la Revue française de sciences politiques, professeure et directrice de l’IEP de Saint-Germain-en-Laye, à travers une enquête qui a largement participé à éclaircir la sociologie des comportements électoraux. Ils se sont penchés sur les causes de l’abstention, et souligne que cela ne tient pas qu’à des facteurs politiques. Cela étant dit, il s’agit d’un défi majeur que les institutions doivent relever pour se relégitimer.
Constatant l’écart croissant entre une majorité sociale et une minorité électorale – qui nous rapprocherait d’une « démocratie de l’abstention » à l’image des États-Unis, Braconnier et Jean-Yves Dormagen ont mené une enquête approfondie pour mieux appréhender les comportements abstentionnistes.
Les deux auteurs ont donc cherché, durant une enquête faite de 2002 à 2006 dans la cité des Cosmonautes à Saint-Denis, à examiner avant tout le contexte de production de vote pour comprendre ses logiques sociales. Cela leur a permis de contextualiser la situation des électeurs et d’avoir accès à ceux qui se cachent, qui ne sont pas intéressés ou qui n’ont jamais la parole.
La démobilisation électorale
Les élections législatives de 1988 ont été le premier tournant fort de démobilisation depuis 1848, puisque, dès lors, l’abstention aux législatives sera toujours supérieure à 30%.
Pour expliquer ce phénomène, les auteurs annoncent qu’aux conceptions traditionnelles qui pensent que l’abstention est soit une volonté politique de rejet, soit un désintérêt pour la politique, s’ajoute une « ségrégation électorale et spatiale », avec toujours environ 10% de non-inscrit.es et de mal inscrit.es sur les listes. En effet, d’après les observations des auteurs qui ont étudié les listes d’émargement plutôt que les déclarations, l’abstentionnisme constant (remarqué à partir des individus bien inscrits) est minoritaire, au contraire de l’abstention liée au décrochage et à la mal inscription des individus (et souvent de leur famille). L’inscription est ainsi, selon eux, devenue « la principale cause de ségrégation électorale », du fait du temps, de la potentielle distance et des procédures bureaucratiques à remplir pour pouvoir voter.
Néanmoins, il ne faudrait pas envisager les mal inscrits comme un groupe homogène : il existe également des disparités en son sein, et ce, selon différents facteurs. De fait, la pratique électorale des mal inscrits est presque intermittente, selon l’intensité des élections (par exemple, les élections présidentielles et européennes ne représentent pas la même mobilisation) et des campagnes, selon la place accordée aux scrutins dans les médias (par exemple, les vives réactions après l’annonce des candidats au second tour des présidentielles de 2002), mais aussi selon l’influence des micro-pressions et incitations à voter dans l’environnement des votants.
De faibles prédispositions politiques
L’observation des deux auteurs est que l’insatisfaction, la perte de confiance et le désengagement sont des facteurs parmi d’autres qui expliquent l’abstention. Elle peut être, en revanche, bien observée par la régularité des mobilisations politiques selon les lieux et les types de scrutins, par la réduction de choix de candidats, et par-dessus tout, par l’environnement et le contexte dans lequel évoluent l’électorat.
En effet, le groupe d’origine et le lien social d’un individu avec les autres a une influence directe sur l’incitation à voter, de même que le rapport au sens civique et au degré de politisation (souvent selon la propre appréciation de son niveau de connaissance). À cela s’ajoute une profonde indifférence – la plupart du temps synonyme d’ignorance (dates, candidats et leur affiliation, programmes) – aux activités et informations relatives à la politique (malgré une forte consommation de la télévision) hors et pendant les périodes électorales, et ce, en particulier chez les jeunes.
En se fondant sur les entretiens et données qu’ils ont extraits de leur étude sur la cité des Cosmonautes, Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen avancent le postulat que lorsque que les individus sont politisés, ils disposent en fait majoritairement de connaissance “a minima”, telles que le clivage droite-gauche. Ces individus sont le plus souvent jeunes (entre vingt et quarante ans), titulaires d’un diplôme, bien intégrés socialement et dans le monde du travail. En relief du désengagement politique, ce sont ces profils qui sont les plus représentés dans les statistiques de vote de la cité.
De faibles prédispositions éthiques
Pour comprendre l’abstention sous un autre angle, les deux auteurs se sont posé la question « Qu’est-ce qui explique que des individus votent toujours alors même qu’ils n’attendent rien ou presque rien de la politique ? ».
Selon eux, cela tient au rapport des individus aux normes civiques, qui est un élément clé de la participation. La légitimation du devoir social implique, en effet, une participation constante et traduit une volonté d’appartenir à la Nation (intégrer les normes dominantes pour se sentir légitime). Au-delà de ce devoir, qui peut être du ressort purement individuel, la fréquentation des lieux du quotidien permet à ces individus d’acquérir des prédispositions à l’acte politique, qui peuvent constituer un facteur de stigmatisation (reproduction sur les autres de ce dont nous craignons d’être accusés en cas de non-participation : d’idiotie, d’égoïsme, de complicité…). Ces prédispositions concernent en majorité les individus les plus stables et engagés dans les études ou carrières professionnelles – à l’exception des retraités –, qui ont tendance à être plus apaisés et respectueux dans leur rapport aux institutions publiques. À l’instar de l’argument précédent, ils sont insidieusement pressés de s’informer afin de pouvoir trouver et prouver la légitimité de leurs votes.
Il s’agit d’un argumentaire qui, selon les milieux, est socialement inefficace, d’autant plus à mesure que l’abstention est déculpabilisée (voire revendiquée) et le vote désacralisé. Par exemple, les démarches administratives nécessaires à l’inscription dans un bureau de vote, alors même qu’un individu entretient une distance, voire un rejet cynique vis-à-vis des institutions, représente un obstacle majeur. Certains individus n’ont pas envie de risquer cet effort, vis-à-vis des administrations dont ils se sentent exclus (rejet simple de « soumission ») ou des discriminations préalablement rencontrées, d’autant plus s’ils ont l’habitude de rejeter ces institutions en groupe.
L’appauvrissement politique des environnements populaires
La mobilisation des votants en 1848, malgré l’analphabétisme et les grandes distances à parcourir, démontre que ce n’est pas seulement par motivation politique ou intérêt personnel que des individus votent. Selon les deux auteurs, cette mobilisation s’est tenue au milieu social et à la pression des communautés / leaders à voter – si ce n’est pas à orienter les votes. Dans cette mesure, les relations interpersonnelles sont toujours déterminantes dans la mobilisation pour un vote, au contraire d’un narratif qui promeut l’expression individuelle des votes (sondage et isoloir par exemple). Cela invisibilise le fait que les individus, par leur participation ou non-participation, se conforment aux attentes de leur milieu d’appartenance et en particulier de leurs proches (famille, couple, amis, collègues, voisins) pour voter.
Dès lors, comment expliquer l’appauvrissement politique des lieux historiquement politisés ? C’est la perte d’influence des syndicats et de la conscience de classe qui explique en partie cette démobilisation, voire d’un réalignement politique pérenne à l’opposé de l’échiquier (facteurs exogènes et propres à la déception de la gauche au pouvoir). De même, la perte de lien social, autrefois permise par la fréquentation de comités citoyens, d’associations, etc. qui permettaient un échange d’information inédit, est allée de concert avec l’affaiblissement de l’offre politique dans les lieux de socialisation secondaire.
Ainsi, même les lieux de travail, avec la fragmentation du monde ouvrier et les changements structurels et stratégiques des entreprises (délocalisation des sites de production, sous-traitance…), les salariés se sont éloignés des organisations et des associations syndicales. Désormais, c’est la stabilité de l’insertion professionnelle qui est synonyme d’engagement politique.
D’après les observations des deux auteurs, les profils les plus susceptibles d’être actifs (voire proactifs) politiquement sont ainsi les salariés diplômés de la fonction publique en CDI, à contrario des personnes en CDD, intérim et stages. Cette instabilité ne permet pas non plus de favoriser le lien social entre employés et donc la capacité à se mobiliser. De surcroît, l’inactivité ou l’absence de perspective d’évolution est souvent le corollaire de la non-inscription sur les listes électorales, induisant la surreprésentation des actifs dans les sondages et analyses électorales.
Enfin, l’absence de transmission de préférence politique au sein de la famille, par exemple, au sein de familles où les parents sont d’origines étrangères (ils n’ont pas le droit de vote ou ne se sentent pas légitimes), ne permet pas non plus d’engagement ni de préférence politique. En considérant les arguments précédents qui stipulaient que la sensibilisation et la pression des cercles sociaux étaient un élément déterminant dans la politisation et la mobilisation, cette abstention fait sens. Dès lors, la famille a un rôle crucial dans l’apprentissage et la pratique électorale, et d’autant plus dans la mesure où les cercles secondaires (les études, les associations ou le travail) sont « dépolitisés ».
*
Jean-Yves Dormagen et Céline Braconnier ont cherché, à travers cet ouvrage, à aller plus loin dans les explications de démobilisation électorale que les arguments usuellement avancés, tels le désenchantement ou la réduction de l’offre politique. Ils constatent qu’elle concerne les individus inégalement selon leur lieu de vie, leur milieu social, leur niveau d’études et de revenu.
L’état actuel de la démobilisation n’est pas à considérer comme irréversible, néanmoins il serait périlleux de prétendre pouvoir prédire les futurs comportements électoraux sur la base des facteurs qu’ils ont décelés, même si les processus de démobilisation électorale sont probablement durables. Ils pensent tous les deux que réinvestir le politique, en ciblant mieux les électeurs, par exemple, n’est pas suffisant puisque cela ne ciblerait pas les éléments non-politiques déterminants pour expliquer l’abstention.
Il convient dès lors d’identifier les tendances de comportements à différentes durées, selon différents milieux et en prenant en compte l’environnement local et social, pour mieux analyser les causes de l’abstention. Ainsi, ils proposent de commencer par nous affranchir des processus d’inscription, mais surtout de déceler les facteurs de démobilisation à investir profondément afin que notre pays « ressemble à nouveau à un pays réel ».