Publié le 22 janvier 2025. Par Cloé Lachaux.
Un seul remède : l’engagement politique
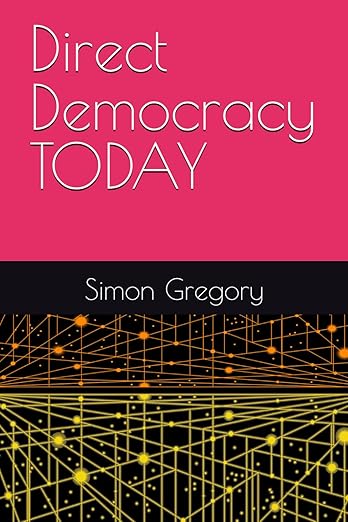 Simon Gregory, Direct democracy today, 2024
Simon Gregory, Direct democracy today, 2024
Simon Gregory a commencé sa carrière en tant qu’artiste, éditeur puis conférencier en business et finance. Après trente ans de carrière, il s’est redirigé vers l’édition et sort son premier livre en 2024. Pour lui, nos systèmes démocratiques souffrent essentiellement de mal-représentation. La solution serait alors de se diriger vers une démocratie semi-directe, où toutes et tous seraient impliqué.es dans le processus politique.
Conscient de la désillusion de la démocratie représentative des citoyens, Simon Grégory cherche, dans cet ouvrage, à détricoter les promesses et idéaux perdus de ce modèle politique. Il envisage la démocratie participative comme un moyen « rafraîchissant » pour corriger les lacunes et pièges dans lesquels est tombée la démocratie représentative. Il propose finalement des pistes de réflexion pour en faire « un manifeste de changements ».
Retour sur les différentes formes de gouvernance
L’auteur définit cinq formes de gouvernance, chacune étant plus ou moins adaptée aux contextes et dynamiques propres à tel ou tel pays.
La première est la démocratie, la seconde l’autocratie (concentration de pouvoirs par un individu ou un groupe restreint), la troisième le fédéralisme (le pouvoir est partagé entre une autorité centrale et des entités subsidiaires, telles que l’Allemagne), la quatrième la gouvernance unitaire (uniformité des lois, des politiques et du pouvoir) et la dernière la gouvernance globale (collaboration internationale et supranationale).
Après avoir dressé ce tableau, l’auteur ajoute qu’il est important, dans nos sociétés modernes, de le compléter avec des éléments qui les nuancent et changent leur structure pour mieux appréhender les défauts et les qualités de ces régimes. Il s’agit ainsi de revaloriser des modes de gouvernance subsidiaire tels que l’anarchie, la tyrannie ou la méritocratie, qui sont très largement regardées comme des alternatives peu viables, mais qui pourraient fait l’objet d’un regain d’intérêt du fait de la défiance contre la démocratie.
À la recherche d’une vraie représentation
Actuellement, le rôle des citoyens est extrêmement limité dans les processus de décision, d’autant plus qu’ils seraient peu ou mal informés lors de leur vote. En effet, les citoyens sont tenus à distance du pouvoir, leur rôle se bornant à exprimer leurs attentes à des représentants qui les mettront ou non en œuvre. La représentation faillit ainsi à sa mission dans la mesure où, au-delà de la tâche qui est loin d’être mince, des facteurs endogènes et exogènes influencent les représentants lors de leurs mandats (recherche d’intérêt personnel ou partisan, jeu de lobby, corruption, manque de transparence, bureaucratie…).
Il apparaît alors nécessaire de redresser ces lacunes en améliorant la transparence, en réduisant l’influence des intérêts propres en politique et en promouvant une culture de responsabilité. Il est également, selon l’auteur, question de protéger nos libertés personnelles dans un monde dans lequel ces intérêts sont propices à l’exploitation de nos informations personnelles (surveillance de masse, collecte des données, analyse et prévision de comportements de consommation physique et psychique…). De surcroît, la concentration de pouvoirs rendrait les citoyens apathiques et plus enclins à se désintéresser des processus de décisions, y compris liberticides, d’où l’urgence de renouveau de l’engagement citoyen.
Il pense que le système de sélection par loterie ou tirage au sort (sélection aléatoire des membres d’une assemblée), en s’inspirant du modèle athénien avait le mérite de permettre la transparence, de lutter contre la corruption et de promouvoir la participation citoyenne en politique – et ainsi redonner confiance aux institutions. Il est donc favorable à son développement, car cela représenterait une plateforme inédite pour que les citoyens déterminent des politiques publiques et s’expriment sur des enjeux sociétaux. Ces assemblées délibéreraient sur des sujets donnés, avec le soutien d’experts, et rendraient des décisions et des recommandations. La légitimité de ces mesures tiendrait à la qualité de représentation démographique et sociale de ces assemblées et à la capacité de réflexion des divers profils. Pour qu’un tel système fonctionne dans nos démocraties modernes, Simon Grégory pense que certains critères sont indispensables, tels que la participation égale et directe et la délibération préalable au vote.
Un modèle plus actuel de démocratie quasi-directe dont on pourrait s’inspirer est le modèle Suisse, dans lequel les citoyens ont besoin d’un nombre de signatures sur une période donnée pour proposer des lois ou révisions constitutionnelles (y compris sur des lois fédérales). Comme le pays est divisé en cantons, le système de gouvernance local est très fort, avec chacun des spécificités concernant la démocratie directe, permettant un management optimal. Selon l’auteur, l’avantage d’un tel système, à la fois hybride (il existe un Parlement, des chambres, etc) et consensuel, est qu’il permet d’équilibrer le pouvoir du Gouvernement, de mieux impliquer les citoyens et d’orienter le travail des représentants et même le débat public.
Mettre en place la démocratie directe
La démocratie directe (ou plutôt semi-directe) est un système dans lequel les citoyens participent directement et activement dans les processus de décision. Bien que résolvant les lacunes de représentation, comment un tel système pourrait restaurer la confiance démocratique et réinvestir les citoyens dans le jeu politique ?
Dans un premier temps, selon l’auteur, il faudrait amplifier la participation des citoyens en politique. Concrètement, au-delà des assemblées citoyennes précédemment évoquées, nous ferions régulièrement entendre nos voix à travers des débats publics, des initiatives et des référendums afin d’assurer notre représentation et d’équilibrer le pouvoir des élites. Le système d’élections serait maintenu, mais renforcé par l’obligation des représentants de composer avec et de rendre compte de leurs actions à des citoyens plus informés et impliqués.
Cette implication serait soutenue par l’accessibilité d’informations, d’expression et de mobilisation permise par les réseaux sociaux. Simon Grégory est partisan d’une réforme de la politique à grande échelle, et il pense que les réseaux sociaux en seront le plus gros catalyseur. La mise en place de plateformes numériques de participation politique (votes, signatures, sondages, plateformes de questions et réponses, enquêtes) et de discussions entre représentants et représentés faciliterait les procédures et l’accessibilité des informations concernant des initiatives, des votes passés et à venir, des débats auxquels participer… Les citoyens seraient ainsi à même de s’exprimer en amont et en aval des sujets discutés afin de donner du relief et un recul sur les mesures adoptées.
Ensuite, l’auteur pense que reconstruire la confiance en politique impliquerait nécessairement de recréer un lien entre les élus et leurs électorats, et ce, en engageant la sphère publique dans l’exigence de responsabilité et en promouvant au plus tôt l’éducation civique. Cette éducation civique (connaissances, compétences, confiance), ne serait pas contingentée au milieu scolaire, mais destinée à l’ensemble des citoyens, pour les familiariser avec leurs futures responsabilités et leur conférer des exigences solides.
Répondre à ces exigences requiert un changement de paradigme, afin que les politiciens soient capables d’intégrité, d’accessibilité, de flexibilité et soient animés par la volonté de servir l’intérêt du peuple. Selon l’auteur, cette exigence ne peut être remplie que si les candidats possèdent des années d’expertises précises – et pas seulement politiques – pour être légitimes.
En outre, Simon Grégory met l’accent sur la délocalisation du pouvoir central et le développement de la souveraineté locale, pour réduire les risques de recherche d’intérêt personnels et de manque de transparence. À l’image des cantons suisses, l’auteur pense que valoriser la légifération locale laisserait une marge de manœuvre cruciale aux collectivités, ce qui permettrait un éventail plus large de solutions et d’éviter la concentration de pouvoirs.
Enfin, l’ensemble de cette nouvelle organisation politique devrait s’attacher à éviter la tyrannie de la majorité en incorporant des mesures et des organes qui assureraient la protection et l’intérêt de tous vis-à-vis des décisions prises. Pour cela, l’auteur souhaite réformer la Constitution afin d’y incorporer des mesures de démocratie directe, de renforcer le pouvoir local et de créer des instances de contrôle pour favoriser la transparence et prévenir des abus au sein des assemblées, mais également du Gouvernement (par exemple, avec des organes indépendants pour vérifier la constitutionnalité des référendums afin d’éviter la corruption, les discriminations et protéger les droits fondamentaux).
*
À la fin de cet ouvrage, Simon Gregory conclut que le système actuel est révolu, et que nous avons besoin de plus de transparence, de responsabilité et de représentation. Selon lui, la réforme est impérative, et elle l’est d’autant plus que nous avons une multitude d’exemples à notre disposition pour voir ce que l’on risque.
Le besoin pressant de repenser nos démocraties pose alors une multitude de questions, et en particulier, en tant que citoyens, celle de savoir si nous voulons d’un système dans lequel nos voix sont de moins en moins entendues, ou pire. Il croit en la résilience de la démocratie et à notre capacité à investir dans notre avenir, et pense que ce n’est pas un objectif idéaliste, mais bel et bien réalisable, qui devrait être au cœur de nos aspirations.



